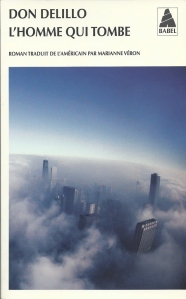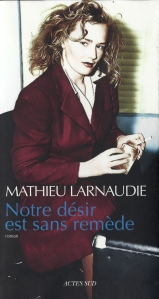Un monde flamboyant, de Siri Hustvedt
(traduit de l’américain par Christine Le Bœuf)
Editions Actes Sud, 2014
http://sirihustvedt.net
www.actes-sud
www.antoineonline.com

La machination de Harriet Burden (1940-2004)
Siri Hustvedt… Selon moi, Siri Hustvedt est une penseuse interdisciplinaire, dont le moyen d’expression majeur est la fiction romanesque. Poétesse, essayiste, et, bien sûr, romancière, elle déploie une activité personnelle intense et méthodique d’exploratrice, de chercheuse autodidacte (admise dans leurs cercles par les spécialistes) en psychanalyse, neurosciences, esthétique, histoire de l’art, philosophie, phénoménologie, épistémologie… ; bref, elle impressionne, et je n’entends pas cela par son CV mais simplement quand on la lit, dans les différents ‘‘genres’’ au travers desquels elle s’exprime, ou quand on l’écoute, dans ses différentes interventions : conférences, ateliers, interviews…, visibles sur YouTube.
Un Monde flamboyant est une anthologie posthume d’articles, d’entretiens et d’extraits des carnets de l’artiste visuelle Harriet Burden – ‘‘Harry’’ pour les intimes –, un recueil de voix, qui aurait pu s’intituler « Voix plurielles et visions multiples » (titre d’un essai de Richard Brickman, p. 11).
Il y a des pages brillantes dans Un Monde flamboyant, qui ‘‘divertissent’’ le lecteur par leurs tonalités différentes, leurs registres de langue différents, par les expressivités variées des divers interlocuteurs de cette ‘‘table ronde’’ fictionnelle autour d’un même sujet, qui n’en accueille jamais plus d’un à la fois, et qui y prennent la parole, et la reprennent parfois, au cours de 45 périodes où 19 personnages, et autant de subjectivités, interviennent avec leurs témoignages, leurs analyses, leurs critiques, leurs commentaires…, sans oublier – note ludique de ce roman présenté (structuré) comme un essai – les notes subpaginales, vraies ou fictives.
Mais, et encore, il y a également – superbe bonus – une ‘‘exposition’’ dans ce roman, carrément une galerie visuelle : l’auteure présente les créations de Harriet Burden (qui sont de l’ordre de l’installation) dans des descriptions vives et nettes qui font voyager le lecteur dans le mental codé de l’artiste, de Vénus poupée géante, affichant « l’Histoire de la pensée occidentale » sur son corps, en boîtes et « chambres de suffocation » habités de personnages qui regardent par des fenêtres… Toutes ces descriptions d’œuvres artistiques manifestent combien Siri Hustvedt, cet orfèvre de la machination verbale, est fascinée par l’art visuel.
Kaléidoscope mental, le texte ainsi morcelé, compartimenté, se laisse déchiffrer comme un puzzle en voie de montage. Bien que le lecteur, une fois la lecture terminée, n’ait pas nécessairement l’impression apaisante d’avoir pu reconstituer ce puzzle – qui est, en fait et obsessivement, celui de la réalité intérieure de Harriet Burden – dans sa totalité.
Qui était donc Harriet Burden, « jolie laide » à la Modigliani, 1 m 88, plus de 55 ans à l’époque, long visage sans grâce, forte poitrine, super bien roulée ? L’une de ces ‘‘tares’’ était d’être une intellectuelle avec une culture hors norme. Son immense érudition éclectique irritait-elle, rebutait-elle certains critiques ? Car ces derniers « aiment avoir l’impression de dominer l’œuvre d’art. Si elle les intrigue ou les intimide, il est plus que probable qu’ils la dénigreront ».
Une autre tare, pour ne pas dire malédiction, à introduire aussi dans l’équation, c’est la question du sexe : « Il a souvent fallu plus de temps aux femmes qu’aux hommes pour prendre pied dans le monde de l’art », ou, mieux : « Toutes les entreprises intellectuelles et artistiques (…) reçoivent un meilleur accueil dans l’esprit de la foule lorsque la foule sait qu’elle peut derrière l’œuvre ou le canular grandioses, distinguer quelque part une queue et une paire de couilles. »
Les artistes femmes ne sont reconnues que très tard dans leur carrière, comme par exemple Alice Neel et Louise Bourgeois, qui n’ont percé qu’après leur 70 ans ; ou alors qu’après leur mort, telles Joan Mitchell et Eva Hesse, dont la place et l’influence n’ont été reconnues à leurs justes dimensions que posthumément.
Et pour mieux enfoncer le clou, « bien que le nombre d’artistes femmes ait explosé, le fait que les galeries new-yorkaises exposent nettement moins de femmes que d’hommes n’est pas un secret », et cela – statistique notoire – malgré le fait que « près de la moitié de ces mêmes galeries est gérée par des femmes ». Les musées exposent surtout des hommes, les revues parlent surtout des hommes, et « presque sans exception, l’art des hommes atteint des prix beaucoup plus élevés que l’art des femmes », lesquelles Harriet définit comme étant des « escamotées ».
Voilà pourquoi, « dans le courant des années 1990, elle avait entrepris une expérience qu’elle mit cinq ans à mener à son terme. Selon Brickman, obscur universitaire intraçable qui enseigne l’esthétique, Burden fit jouer à trois hommes le rôle de prête-nom, de pseudos, de « masques », pour son propre travail créatif. Trois expositions en solo dans trois galeries new-yorkaises, attribuées à Anton Tish (1999), à Phineas Q. Eldridge et à l’artiste connu sous son seul prénom, Rune (2003), avaient en réalité Burden pour auteur. Elle avait intitulé le projet dans son ensemble Masquages, et déclaré que son propos ne consistait pas seulement à mettre en évidence le préjugé antiféministe du monde de l’art, mais aussi à révéler les rouages complexes de la perception humaine et la façon dont des notions inconscientes de genre, de race et de célébrité influencent la compréhension que peut avoir le public d’une œuvre d’art donnée ».
Et Brickman attribue aussi ces propos à Harriet Burden : « Chaque artiste-masque devient pour Burden une ‘‘personnalité poétisée’’ (l’expression est de Kierkegaard), l’élaboration visuelle d’une ‘‘entité hermaphrodite’’ dont on ne peut dire qu’elle est la sienne ni celle du masque, mais qui relève ‘‘d’une réalité confondue créée entre eux’’. »
Harriet Burden aurait-elle dû se grimer en homme ? Non, elle avait passé l’âge et, en tout cas, n’avait « jamais eu de pénis » : « Mais cela m’intéressait-il d’expérimenter avec mon propre corps, de sangler mes doudounes et de rembourrer mon pantalon ? Avais-je envie de vivre comme un homme ? Non. Ce qui m’intéressait, c’étaient les perceptions et leur mutabilité, le fait que nous voyons surtout ce que nous nous attendons à voir. »
Alors, elle va prendre le chemin des « communications indirectes » de Kierkegaard, faire des « excursions artistiques » sous des pseudonymes, s’amuser avec le processus de la perception de l’œuvre d’art dans le monde et le marché de l’art, en arborant des « masques » au travers de doubles, de doublures.
Pourtant, ce qui deviendrait par la suite sa démarche ludique et cynique d’artiste masquée, célèbre et inconnue, n’est pas encore défini dans sa tête. Elle va s’essayer dans des tentatives qui la font jubiler de plaisir anticipé à l’idée de berner ceux qui se prennent pour des éclairés : « Sœren Kierkegaard n’avait-il pas, sous le pseudonyme de Notabene, écrit une série de préfaces que ne suivait aucun texte ? Et si j’inventais un artiste qui n’était que critique d’art, que transcription de catalogue, et pas d’œuvre ? Combien d’artistes, après tout, avaient été catapultés dans l’importance par les sornettes rédigées par ces pisse-copie qui avaient acquis le tour linguistique ? Ah, écriture ! L’artiste devrait être un jeune homme, un enfant terrible dont le vide engendre des pages et des pages et des pages de texte. Oh, quel plaisir ! »
Cependant, trop lucide pour s’engager dans cette voie sans issue, elle, qui avoue désirer se « venger des crétins, des imbéciles et des sots » et qui s’en veut de s’être morfondue dans « un isolement intellectuel continu et douloureux » parce qu’elle s’est toujours sentie « incomprise », va donc exposer son œuvre, via ses masques, via un « corps-de-vingt-quatre-ans-avec-queue » (dit-elle à propos de l’un d’eux, Anton Tish) et elle mystifierait « ces gens-là » qui l’avaient persécutée ou ignorée et qui, un jour, allait le regretter : « Toutes les idées de vengeance naissent de la douleur de se sentir impuissant. Je souffre devient tu vas souffrir. Et, soyons honnêtes : la vengeance est revigorante. Elle nous donne un but et nous anime, et elle annule le chagrin car elle détourne l’émotion vers l’extérieur. Dans le chagrin, nous nous effondrons. Dans la revanche, nous nous reconstituons en une arme unique visant une cible. Si destructrice qu’elle soit à long terme, elle remplit provisoirement une fonction utile. »
L’auteure de cette réflexion sur la relative valeur thérapeutique de la vengeance, Rachel Briefman, psychologue et amie de Harriet, dira que « son idée ne consistait pas simplement à exposer ceux qui étaient tombés dans son piège, mais à étudier la dynamique complexe de la perception proprement dite, de la manière dont nous créons ce que nous voyons, afin d’obliger les gens à examiner la façon personnelle de regarder et de démonter leur présomption ».
Cette expérience sera à double tranchant, avec des répercussions déstabilisantes sur les deux parties. Par exemple, le jeune Anton Tish, son premier masque, deviendra complètement inhibé, castré, sous l’effet de la complexe nébuleuse psycho-intellectuelle de son mentor, qui a envahi son crâne. Il ne pourra plus travailler à son œuvre personnelle et crachera de ressentiment à la face de Harriet que sa contribution à lui est « énorme » puisque « la célébrité, ce n’est pas ce qu’on fait ; c’est être vu. C’est occuper la scène » et que ses œuvres à elle, exposées, n’existent donc que parce que le public l’a identifié, lui, Anton Tish, comme étant leur auteur. Le doute taraudera alors Harriet : « Peut-être que personne n’avait aimé ses boîtes. Peut-être les boîtes ne s’étaient-elles vendues que parce qu’Anton Tish était supposé les avoir faites. » Elle qui s’apprêtait à revendiquer publiquement son œuvre, à dévoiler sa manipulation, va décider d’attendre ; et elle se lancera dans une nouvelle expérience avec un nouveau masque (jeune métis gay) puis un troisième (jeune artiste fatal)…
La place de Harriet Burden, l’artiste, dans le monde de l’art, et sa perception par les ‘‘spécialistes’’, critiques, galeristes, etc., pourrait être rendue avec assez d’exactitude objective par les propos de la critique d’art Rosemary Lerner. Celle-ci n’a pas recours à la simplification qui tend à présenter tel ou tel artiste soit comme un héros tragique, soit comme une victime ou un génie. Selon elle, Harriet n’était pas du tout obscure ou ignorée. Elle avait cinq expos à son actif dans les années 1970, et plusieurs critiques, dont Lerner, avaient favorablement commenté sa production. Et même si ses deux galeristes-marchands d’art ne l’ont pas soutenue jusqu’au bout, cela n’est pas exceptionnel mais « place seulement Harriet Burden dans la catégorie des nombreux artistes visuels éminents, hommes et femmes, qui furent respectés par les autres artistes, envers qui la critique fut partagée et dont l’œuvre n’attira pas les gros collectionneurs ».
D’ailleurs, l’intéressée elle-même ne pensait pas « qu’il y ait eu complot contre elle. Il y a beaucoup d’inconscient dans le préjugé. Ce qui affleure à la surface, c’est une aversion non identifiée, que l’on justifie alors de quelque façon rationnelle. Être ignoré, c’est peut-être pire : cette expression d’ennui dans le regard de l’autre, cette assurance que rien de ce qui vient de soi ne peut présenter le moindre intérêt ».
Ce commentaire introductif à Un Monde flamboyant, avec ce qu’il suggère des enjeux narratifs et philosophiques de ce roman ambitieux, qui brille des mille éclats de l’intellect créatif qui transcende la notion de sexe appliquée à nos fonctions et capacités cognitives, devrait suffire à mettre l’eau au cortex de n’importe quel lecteur assez intelligent pour désirer frotter son front contre celui de l’auteure et en voir jaillir des étincelles.
Je ne saurai donc aucunement ne serait-ce que même lancer une insinuation sur la manière dont ce récit aborde sa résolution, centrée sur l’aura pérenne de l’œuvre artistique.
J’ajoute simplement que Siri Hustvedt invite son lecteur à jouer avec les perceptions, qu’elle déconstruit l’axiome binaire qui identifie féminité avec passion et masculinité avec intellect, en montrant un personnage féminin qui « peut voler, intellectuellement, comme les hommes », que le titre Un Monde flamboyant vient de Margaret Cavendish, philosophe et dramaturge du 17e siècle, à la pensée de laquelle Siri Hustvedt nous introduit, moins par la présentation de ses écrits que par la transposition dans la narration de leur caractère dialogique, qu’il est question d’aveux en palimpseste (excitant stratagème !), de « cécité inattentionnelle », et que mémoire et imagination sont incestueusement liées, que Siri Hustvedt, selon Harriet Burden, est une « obscure romancière et essayiste », que la théorie du genre a de beaux jours de prosélytisme devant elle, que le « moi hermaphrodite » est le résultat d’une conjuration binaire, que la fracture entre le biologique et l’artificiel se consume, que Penelope sera toujours matée par Ulysse et qu’à tant voguer un vaisseau finit par se briser…
Je conclus avec cette réflexion de Harriet devant le miroir : « J’oubliais que j’avais des rides, des seins nécessitant un soutien-gorge costaud et un ventre d’âge mûr, proéminent comme un melon. Une telle amnésie est notre phénoménologie du quotidien – nous ne nous voyons pas – et ce que nous voyons devient nous pendant que nous le regardons. »
Et en guise de conclusion, que j’ai voulue digressive, je dois dire ceci : Christine Le Bœuf, traductrice perspicace, pénétrante, créative et passionnée d’Un Monde flamboyant, a fait un travail remarquable.
© Johnny Karlitch, 52 romans par an, semaine 19 : lundi 9 au dimanche 15 février 2015.